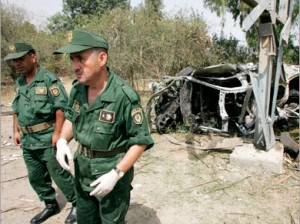Dans son numéro 757, la prestigieuse Revue Défense Nationale, revue française s’occupant des questions de défense dans le monde, vient (en février 2013) de publier un article du général de l’armée de l’air Bernard Norlain où il a recensé élogieusement le dernier livre de Peter Dale Scott qui s’intitule « La Machine de guerre américaine ». Poète et professeur à Berkeley, l’auteur américain avait quelques mois auparavant décliné ce travail de fourmis sur les cas d’instrumentalisation de la violence illégale par les organismes publics américains, soit à l’intérieur des Etats-Unis eux-mêmes, soit à l’extérieur. Le général français fut impressionné par l’apport de l’œuvre. Reconstituant d’une manière très soignée et précise des exemples retentissants de l’usage en sous-main du terrorisme par les autorités américaines elles-mêmes et à une échelle extravagante empruntant des procédés qui font place à l’assassinat, au mensonge, au kidnapping, au trafic des narcotiques et à nombre d’autres éléments interdits, le livre est en effet impressionnant. Cette « violence de l’État profond » comme aime la désigner l’auteur, se produisait déjà avant-même que le vocable « terrorisme » ne soit définitivement consacré par l’Administration américaine comme expression désignant l’activité de certains mouvements révolutionnaires dans le monde, et surtout les actes antisionistes de la résistance palestinienne. Les «événements profonds » qu’illustrent les crimes ordonnés dans le cadre de la politique intérieure ou étrangère secrètes par la « machine de guerre américaine », sont systématiquement ignorés, supprimés ou falsifiés dans les documents publics du gouvernement, de l’armée et des renseignements, ainsi que dans les médias de masse et la conscience collective. Traitant ces différentes formes de criminalité́ et de violences autorisées, l’auteur espère reconstituer un pan important d’une mémoire obstruée ou déconstruite à coup de mensonges et de destruction de preuves pour des crimes relevant des agissements des représentants de l’Etat profond. Nous livrons à nos lecteurs des extraits de l’introduction que l’auteur avait choisie pour son livre qui se présente comme un pamphlet sur un sujet des plus inédit.
Sami Shérif
La Machine de guerre américaine
Peter Dale Scott

Deux chercheurs face à un événement profond
Si, par terrorisme, nous entendons « l’usage de la violence pour intimider », alors l’historien Alfred McCoy et moi-même avons assisté, en septembre 1971, à un événement terroriste de faible intensité en Californie. Résidant à East Palo Alto, un vétéran des Forces spéciales déployées au Vietnam, qui avait été témoin en Asie de chargements d’opium dans les avions d’Air America (la compagnie aérienne de la CIA), nous donna par téléphone son accord pour un entretien. Mais lorsque nous arrivâmes chez lui le lendemain matin, il avait changé d’avis. Nous faisant signe de nous taire, il nous précéda depuis le seuil de sa maison jusqu’à sa voiture de sport, une MG garée en contrebas. Tard dans la nuit, quelqu’un l’avait dissuadé de nous parler en faisant un large trou dans l’acier de sa portière avec ce qui, d’après lui, ne pouvait être qu’un engin explosif sophistiqué – du type de ceux utilisés par son ancienne unité.1
On pourrait penser qu’il est difficile d’oublier un événement aussi marquant et incongru, en particulier parce qu’il avait été clairement provoqué par notre conversation téléphonique. Mais en fait, je l’avais totalement effacé de ma mémoire pendant plus d’une décennie, y compris durant les deux premières années d’une recherche entreprise pour recouvrer de tels souvenirs.2 Comme je l’avais pressenti avec justesse, Alfred McCoy lui aussi avait oublié cet événement. Dans la préface de l’édition 2003 de sa monumentale étude The Politics of Heroin, un ouvrage de référence, il décrit ainsi cet étrange oubli :
« J’ai atterri à San Francisco pour un séjour avec le poète Peter Dale Scott, professeur à Berkeley. Il me mit en contact avec un ancien Béret Vert revenant tout juste d’opérations clandestines au Laos. Au téléphone, celui-ci m’avait indiqué avoir vu un avion de la CIA transportant de l’opium.
Il acceptait de nous donner un entretien enregistré. Le lendemain matin, nous frappions à sa porte, dans un immeuble d’habitations situé à East Palo Alto. Nous ne sommes jamais entrés chez lui. Il était visiblement bouleversé, disant qu’il ‘avait reçu le message’. Que s’était-il passé ? ‘Suivez-moi’ dit-il, nous dirigeant à travers le parking en direction de sa voiture de sport de marque MG. Il pointa du doigt la portière du côté passager, et il nous parla d’un explosif chimique qui pouvait creuser un trou dans la tôle en la faisant fondre. C’était, selon lui, un signal pour qu’il se taise. J’ai regardé le trou mais je ne peux me souvenir de l’avoir vraiment vu. Le lendemain, j’ai pris l’avion vers Los Angeles, pour rendre visite à ma mère avant de m’envoler pour Saigon, oubliant complètement l’incident. »3
M’étant remémoré cet épisode 30 ans plus tard, il me semblait moins surprenant. À l’époque, les États-Unis étaient pris dans la tourmente, et même des activistes anti-guerre non violents comme moi étaient soumis à une surveillance continuelle. Des événements encore plus graves se déroulaient alors. À San Diego, « des miliciens menés par un informateur du FBI ont saccagé l’équipement d’imprimerie d’un journal [anti-guerre], ont lancé une bombe incendiaire sur la voiture de l’un de ses membres et ont failli tuer par balles une autre personne du journal. »4 À la même époque à Chicago, « Le 113e Groupe des Renseignements militaires […] a fourni de l’argent, des grenades lacrymogènes, des sprays défensifs MACE et de l’équipement de surveillance électronique aux voyous de la Legion of Justice, dont la Red Squad de Chicago, qui s’est mise à brutaliser les groupes pacifistes locaux. »5 Les crimes que je viens d’évoquer – à Palo Alto, à San Diego et à Chicago – sont des exemples de ce que j’avais initialement conçu comme relevant de la « violence de l’État profond », et que je qualifierais à présent de « violence générée par une force profonde » (car provoquée par une source obscure inconnue et/ou illicite). Dans cette perspective conceptuelle, il existe de nombreuses formes de violence non étatique – mais approuvée par l’État – dont les origines sont profondes. Dans la majorité des cas, cette violence illégale résulte d’une tâche assignée par une agence officielle à des bandes organisées agissant hors du cadre légal. Il existe aussi des cas de violence « sous-traitée », lorsque celle-ci n’est pas déléguée à des acteurs non étatiques mais à des agences gouvernementales étrangères.
Finalement, il existe des cas dans lesquels la violence renforce la structure de pouvoir qui dirige de facto le pays, sans directement impliquer la CIA ou d’autres agences de l’establishment. Une telle forme de violence peut être expressément autorisée par des membres de la structure de pouvoir officielle ; ou bien être approuvée passivement en évitant d’en sanctionner les responsables. Dans le Sud des États-Unis, les lynchages extrajudiciaires constituaient une application de facto de la ségrégation raciale illégale instaurée par les lois Jim Crow. Les confiscations de terres dans l’Ouest américain furent accomplies par des exactions encouragées par la presse contre les Amérindiens – les premiers à vivre là, et dont la plupart étaient non violents.6 Cette tolérance culturelle à la violence et au meurtre a débordé sur d’autres aspects de la vie états-unienne, notamment à travers la casse des syndicats. (En 1914, à l’issue du « Massacre de Ludlow » survenu durant une grève des mineurs contre la Colorado Fuel & Iron Company de Rockefeller, un seul casseur de grève fut condamné, et il ne reçut qu’une légère réprimande.7)
La plupart d’entre nous – moi y compris – n’aimons pas nous étendre sur des pratiques aussi dérangeantes au sein même des États-Unis, et c’est la raison pour laquelle Alfred McCoy et moi-même avons tous deux supprimé de nos mémoires ce qui s’est passé à East Palo Alto. Mais ces pratiques persistent, aux États-Unis et à travers le monde. Et l’une des raisons expliquant leur persistance est précisément notre réticence à y songer.
J’ai écrit ailleurs que la civilisation est une « vaste conspiration de déni organisé ».8 J’entends par là la création d’un espace mental collectif partiellement illusoire dans lequel les faits déplaisants, comme l’établissement de tous les empires occidentaux par des atrocités majeures, sont occultés de manière arrangeante.9 Je l’exprime comme quelqu’un qui croit passionnément à la civilisation et qui craint que celle-ci, à cause d’un déni excessif, en vienne à être menacée.
Il existe des conséquences sociales et politiques de notre échec à reconnaître et à affronter les forces violentes qui sont à l’œuvre aux États-Unis, en particulier concernant leur collaboration fréquente avec des agences officielles de renseignement et de police – agences dont la mission première est de protéger le peuple. Sur le plan individuel, le fait que nous escamotions de tels détails troublants contribue probablement à maintenir notre santé mentale. Cependant, ce refoulement collectif nous mène à des politiques qui sont de plus en plus en décalage avec la réalité et inefficaces, à mesure que notre attention se détourne simultanément de tous les principaux abus.
En traitant des différentes formes de criminalité et de violence autorisées, j’espère reconstituer un large pan de cette mémoire effacée. Mais la rédaction de ce livre m’a conduit à considérer mon expérience à Palo Alto – et en fait tout phénomène de ce type – comme des exemples de ce que j’appelle à présent des « événements profonds » : des événements qui sont systématiquement ignorés, supprimés ou falsifiés dans les documents publics (et même internes) du gouvernement, de l’armée et des renseignements, ainsi que dans les médias de masse et la conscience collective. Habituellement, le dénominateur commun à ces événements est l’implication de forces profondes liées au trafic de drogue et/ou aux agences de renseignement, dont les activités sont extrêmement difficiles à discerner ou à documenter.
Pour donner une définition précise d’un événement profond, celui-ci a des caractéristiques internes : des preuves que certains de ses aspects ont été supprimés, et que par conséquent il existe une dissimulation perceptible. Il possède également des caractéristiques externes, car il engendre une controverse persistante et probablement impossible à résoudre sur ce qui s’est véritablement déroulé. Certains événements profonds – les assassinats de 1968, les incidents du golfe du Tonkin et le 11-Septembre – cumulent clairement ces deux types de caractéristiques. Ce n’est pas systématiquement le cas. Par exemple, le naufrage de l’USS Maine dans le port de La Havane [en 1898] continue de susciter enquêtes et débats, bien que les défenseurs de l’hypothèse d’une opération sous fausse bannière ne disposent d’aucune preuve concluante.10
Mon expérience m’amène à penser que les événements profonds sont mieux compris lorsqu’ils sont étudiés dans leur ensemble plutôt qu’analysés de manière isolée. Observés collectivement, ils forment un schéma plus vaste : celui de l’Histoire profonde. Avant le 11-Septembre, j’ai remarqué que durant des années, le cours de l’Histoire basée sur les archives ou les enregistrements officiels avait été interrompu par des événements profonds, comme l’assassinat de John F. Kennedy. Ces péripéties sont publiquement attribuées à des agents marginaux dont la capacité de nuisance a été surévaluée – à l’image de Lee Harvey Oswald. Cependant, d’un point de vue cumulatif, la succession historique d’événements profonds comme Dallas, le Watergate et le 11-Septembre a eu de plus en plus d’impact sur la situation politique des États-Unis. Plus précisément, comme je tenterai de le démontrer, les principales guerres états-uniennes ont toutes été précédées, de façon symptomatique, d’événements profonds comme les incidents du golfe du Tonkin, le 11-Septembre et les attaques à l’anthrax de 2001. Cela suggère l’hypothèse selon laquelle ce que j’ai appelé la « machine de guerre » à Washington (comprenant des éléments du Pentagone et de la CIA, mais pas seulement) aurait pu être derrière ces événements. Après avoir rédigé les derniers chapitres de ce livre, j’en suis venu à appuyer encore plus vigoureusement cette conclusion. Depuis 1959, la plupart des guerres qu’ont menées les États-Unis à l’étranger ont été induites de façon préemptive par la machine de guerre US et/ou présentées comme des réponses à une agression ennemie non provoquée, impliquant d’une manière ou d’une autre la connexion narcotique globale.
Par ailleurs, ayant terminé ce livre, j’ai à l’esprit une image nettement plus claire de la responsabilité pleine et entière des États-Unis dans le trafic de drogue international depuis la seconde guerre mondiale. Nous pourrions par exemple illustrer cela par le fait que la production d’opium en Afghanistan a plus que doublé depuis l’invasion de ce pays par les États-Unis en 2001. Mais la responsabilité US pour le rôle prédominant de l’Afghanistan dans le trafic mondial d’héroïne aujourd’hui n’est qu’une résurgence de ce qui s’était déroulé entre les années 1940 et 1970 en Birmanie, en Thaïlande et au Laos. Ces pays sont aussi devenus des acteurs majeurs du trafic de drogue international grâce à l’aide de la CIA (après celle des Français, concernant le Laos), une aide favorisant ceux qui seraient restés de simples trafiquants locaux sans cette intervention de l’Agence. Par conséquent, ce livre replonge dans le passé, entre la fin des années 1940 et le début des années 1950, lorsque l’on peut entrevoir les circonstances obscures dans lesquelles la CIA a commencé à faciliter le trafic de drogue en Asie du Sud et du Sud-Est – ces actions de l’Agence trouvant leur point culminant en Afghanistan.
L’écriture de ce livre m’a permis de développer d’autres réflexions à partir de l’incident de Palo Alto, et particulièrement l’importance de sa date – septembre 1971. Comme nous le verrons, c’était une époque de changements majeurs dans la relation qu’entretenaient les États-Unis avec le trafic de drogue du Sud-Est asiatique. En juin 1971, Nixon avait déclaré une « guerre contre la drogue » et en septembre le Laos, suivant les instructions de l’ambassade américaine, venait de décréter l’illégalité de l’opium. Après deux décennies de soutien de la CIA aux seigneurs de guerre et trafiquants de drogue en Birmanie et au Laos, des éléments au sein de l’Agence commençaient à faire fuiter des récits partiels mais importants, qui exposaient cette situation à des journaux comme le New York Times.11 À Washington, des anciens de la CIA comme Edward Lansdale et Lucien Conein venaient tout juste de donner des informations sur la politique de l’héroïne à Al McCoy, qui vécut avec moi l’incident de Palo Alto.12 Peu avant, un chercheur du campus de l’Université de Californie, avec lequel j’avais initié le contact (c’est du moins ce que je pensais), me conseilla de rechercher dans les archives des éléments jusqu’alors inconnus, comme la carrière de Paul Helliwell et son entreprise Sea Supply Inc., un paravent de la CIA. Il s’avéra plus tard que le chercheur en question était lui aussi un vétéran de l’Agence. Je soupçonne aujourd’hui – ce qui n’était pas le cas à l’époque – que ma source me fournissait des indications dans le cadre d’un plus vaste scénario. Le projet de divulgation par la CIA de la politique de l’héroïne rencontra-t-il à Palo Alto l’opposition d’une autre force souterraine déterminée à l’empêcher ? Ou bien ces deux forces profondes apparemment distinctes n’étaient-elles en réalité qu’une seule, œuvrant à Palo Alto pour fixer le cadre d’une divulgation préalablement délimitée ? Je ne le sais toujours pas, mais écrire ce livre m’a aidé à mieux comprendre les développements historiques importants de 1971 (voir le chapitre 6).
Dans des versions antérieures de cet ouvrage, j’ai attribué la responsabilité de la violence autorisée de l’incident de Palo Alto – comme de l’assassinat de Letelier dont je m’apprête à parler – à la CIA et sa connexion narcotique globale. Cependant, cette assertion ne résout pas un mystère, elle en crée un. Sur le plan descriptif, « la connexion narcotique globale » semble plus précise que certaines expressions employées dans mes précédents livres : « le sombre quadrant » depuis lequel les événements para-politiques émergent, ou « l’occulte Force X opérant à travers le monde », dont j’ai suggéré qu’elle pourrait contribuer à expliquer le 11-Septembre.13 Mais cette précision est trompeuse. En effet, dans cet ouvrage, je tente de délimiter et de décrire une (ou des) force(s) profonde(s) que je ne comprends pas totalement. Ce mystère concerne, par exemple, les carrières d’hommes comme Willis Bird et Paul Helliwell, ou des institutions comme la Bank of Credit & Commerce International [BCCI], qui étaient utiles à la CIA autant qu’au trafic de drogue international. Néanmoins, je défendrai l’idée que si nous ne portons pas une plus grande attention à cet aspect ignoré de la machine de guerre des États-Unis, nous ne viendrons jamais à bout des forces qui sont derrière la malheureuse implication états-unienne en Afghanistan.
La drogue, l’État et l’assassinat de Letelier
En 1976, l’assassinat de l’ancien diplomate chilien Orlando Letelier dans les rues de Washington constitua une grave manifestation de violence autorisée (ou, en d’autres termes, d’une force profonde mystérieuse). Ce fut un événement profond secrètement planifié, dont il était certain que les faits cruciaux allaient être supprimés dès le début ; un événement dont les organes d’information de masse ont échoué à révéler les détails, et qui a valu aux quelques universitaires l’ayant étudié le terme moqueur de « théoriciens du complot ».
En un quart de siècle, des faits essentiels concernant l’assassinat de Letelier ont lentement émergé, et ils ne sont aujourd’hui plus remis en question. Nous savons à présent que Letelier a été tué sur ordre de l’agence de renseignement chilienne DINA [Dirección de Inteligencia Nacional], avec la collaboration d’un dispositif supranational d’assassinats, l’opération Condor, que la CIA avait contribué à créer.14 Nous reviendrons plus en détails sur l’opération Condor et ses connexions narcotiques dans cet ouvrage. Dans le cas présent, l’important est que la DINA, Condor et les Cubains américains qui furent impliqués dans l’assassinat de Letelier l’étaient aussi dans le trafic de drogue. Cet homicide comportait des aspects états-uniens autant que chiliens.15 Peu avant le meurtre, le secrétaire d’État Henry Kissinger bloqua une mise en garde urgente proposée par son Département, qui sommait les États d’Amérique latine participant à l’opération Condor de ne pas s’engager dans des assassinats.16 Deux jours après l’homicide, George H. W. Bush, alors directeur de la CIA, reçut une note rapportant l’hypothèse – qui se révéla exacte – selon laquelle « si c’est le gouvernement chilien qui a ordonné le meurtre de Letelier, il pourrait avoir engagé des voyous cubains [de Miami] pour le faire ».17 Pourtant, les semaines suivant l’assassinat, la presse US relaya des récits avançant que le FBI et la CIA, comme le déclara le New York Times, « avaient quasiment exclu l’hypothèse que M. Letelier ait pu être tué par des agents de la junte militaire chilienne ».18 La CIA possédait des preuves contre la DINA lorsque le FBI rencontra Bush pour parler de la coopération de l’Agence dans l’enquête sur le meurtre de Letelier. Mais Bush ne transmit pas ces dossiers, ce qui pourrait l’avoir rendu coupable d’obstruction de justice.19
Je suis d’accord avec John Prados sur le fait que, dans cette affaire, la CIA était complice du terrorisme de la DINA et de Condor :
« La réticence des autorités US à enquêter sur les liens entre l’assas- sinat de Letelier et la DINA permet de mesurer la collusion entre Washington et le Chili à ce moment-là. Condor devint un véritable réseau terroriste. […] À travers ses actions au Chili, la CIA contribua à provoquer ces horreurs. […] En particulier, il existe des preuves évidentes indiquant que l’assassinat de Letelier aurait pu être évité, mais qu’il ne l’a pas été. » 20
La connexion narcotique de ce meurtre est habituellement ignorée, y compris dans les comptes-rendus les plus pertinents de l’assassinat de Letelier. Pourtant, comme nous le verrons, le Mouvement nationaliste cubain [CNM], où avaient été sélectionnés les assassins cubains de Letelier, se serait financé grâce au trafic de drogue organisé par la DINA.21 Que le gouvernement des États-Unis ait dissimulé un assassinat financé par la drogue et perpétré dans sa propre capitale est un autre fait que mon esprit persiste à refouler, bien que j’aie déjà écrit sur ce sujet à deux reprises. Cet événement est une indication de plus mettant en lumière un fait aisément effacé des mémoires, c’est-à-dire l’implication récurrente des organisations du trafic de drogue dans les assassinats liés à la CIA.
La perpétuelle compromission des États-Unis dans la connexion narcotique globale, l’un des principaux thèmes explorés dans ce livre, constitue une tendance destructrice qui a persisté jusqu’à aujourd’hui. Dans le prochain chapitre, je défendrai l’idée que ce n’est pas une activité à part, ayant des origines externes à la structure sociopolitique fondamentale des États-Unis. Je démontrerai au contraire qu’elle est une caractéristique et une cause intégrale d’une plus vaste machine de guerre : un système avec un but affirmé, centré sur l’accomplissement et le maintien de la domination des États-Unis sur le reste du monde.
Les événements profonds et la violence illégalement approuvée
Je qualifie d’événement profond le meurtre de Letelier, car l’implication d’alliés secrets bénéficiant d’une protection en a fait un événement dont la vraie nature serait – du moins initialement – dissimulée au lieu d’être divulguée par les médias de masse US. De plus, les forces le sous-tendant étaient trop profondément liées à des opérations clandestines de renseignement pour en assurer une résolution rapide par les procédures judiciaires et policières traditionnelles. Ainsi, c’est un exemple de violence autorisée, expression par laquelle je ne sous-entends pas qu’il a été préalablement approuvé par des responsables états-uniens (sur ce point, je n’ai aucune information), mais que ses exécutants furent protégés à chaque étape par d’autres personnes évoluant à des niveaux d’autorité supérieurs.
De nombreux citoyens des États-Unis sont au moins vaguement conscients que nous avons connu, au cours du dernier demi-siècle, un certain nombre d’événements profonds comparables impliquant cette forme de violence autorisée. Certaines de ces tragédies, dont les meurtres de John F. Kennedy, de Martin Luther King Jr et de Robert Kennedy, ont eu une considérable influence structurelle sur l’évolution de l’Histoire politique des États-Unis. Dans mon livre La Route Vers le Nouveau Désordre Mondial, j’ai défendu l’idée que nous devrions considérer les attaques du 11-Septembre comme un autre exemple d’événement profond, un autre chapitre dans l’Histoire occulte de notre nation.
Le problème de la violence illégalement approuvée et protégée – une violence régulièrement supprimée de nos consciences – n’est pas nécessairement attribuable à l’État tel que nous le concevons traditionnellement. Par exemple, nous ne savons pas si un quelconque pays a été directement impliqué dans le meurtre inexpliqué de Roberto Calvi, (1982), un banquier italien lié aux scandales entourant la banque du Vatican; il a même été avancé que le Pape Jean Paul Ier aurait été assassiné par ceux qui étaient impliqués dans ces mêmes scandales. Mais là où il y a dissimulation, comme dans l’affaire Calvi, les meurtriers ont bénéficié d’une connexion étatique.22
Au sein même des États-Unis, l’implication de la CIA dans la violence autorisée est indissociable du recours occasionnel à la violence du crime organisé par le monde des affaires US. C’est une longue histoire, depuis l’implication de gangs avec des entreprises de fruits au XIXe siècle puis – peu après – dans la guerre des journaux [entre William Randolph Hearst et Joseph Pulitzer] ; dans l’utilisation de truands par Andrew Carnegie, Henry Ford et d’autres pour combattre les syndicats de travailleurs ; jusqu’à la prise de contrôle des syndicats par la corruption mafieuse dans les industries des transports, du textile, de l’hôtellerie et du divertissement; et potentiellement jusqu’à la mort dans un crash d’avion, en 1970, de Walter Reuther, président du syndicat United Auto Workers.23
Les gens riches ayant une mentalité politique à l’origine de ce que j’ai appelé́ le supramonde, ont des raisons de tolérer la violence mafieuse – ce qui ne vient pas à l’esprit des plus modestes. Au minimum, ils ne sont en principe pas mécontents de constater l’affaiblissement des autorités policières et judiciaires de villes comme Chicago ou la Nouvelle-Orléans, mises à mal par la corruption mafieuse. Pour influencer des législateurs corrompus, ils se tourneront fréquemment vers les mêmes éléments criminels aux niveaux local ou national. Et de temps à autre, ils auront recours à la violence mafieuse pour accomplir leurs propres objectifs politiques, jouissant d’une grande impunité dans les républiques bananières, et parfois même dans leur propre pays.
Cet aspect de l’Histoire n’a jamais été convenablement écrit. Mais le rôle du crime organisé dans la corruption des politiciens a servi les intérêts du monde des affaires, qui regroupait des personnes enviant parfois ce pouvoir d’influence. Et lorsque la CIA en est venue à utiliser des mafieux pour commettre des actes violents – comme John Roselli, Sam Giancana et Santos Trafficante dans la tentative d’assassinat de Fidel Castro – l’Agence s’est tournée vers les mêmes personnes-ressources.24 En agissant ainsi, la CIA a établi avec les milieux de la drogue des connexions comparables à celles créées à travers le monde par des multinationales plus anciennes, comme American & Foreign Power – un exemple typique étant la cession (en 1937) du bail d’un champ de course de La Havane à Meyer Lansky par la National City Bank de New York (rebaptisée depuis Citibank).25
Ces exemples tirés du monde des affaires m’amènent à en déduire que, lorsque l’on étudie la politique de la violence, il faudrait observer l’ensemble des pouvoirs profonds – ou non reconnus – qui maintiennent un statu quo violent dans notre société ; un ensemble qui implique les bureaucraties, les agences de renseignement, le monde des affaires et même les médias. Le trafic de drogue est également compris dans ce vaste ensemble, et il est une caractéristique récurrente de notre Histoire profonde. La branche du supramonde qui blanchit l’argent de la drogue ou qui emploie des criminels pour ses besoins privés en est aussi une. Dans un nombre extraordinaire de zones urbaines, les vies quotidiennes de nombreuses personnes ordinaires sont avant tout déterminées par leurs dettes envers les trafiquants de drogue locaux plutôt qu’envers l’État public. Ces personnes ont conscience que si elles ne peuvent plus payer leurs impôts, elles s’exposent à des amendes ou même à des peines de prison ; mais elles savent également que si elles ne peuvent honorer une dette de drogue, quelqu’un dans leur entourage – potentiellement un être cher – peut être tué.
Max Weber a défini l’État moderne viable comme une entité́ qui «revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime [Gewaltmonopol] ».26 C’est sur la base de cet idéal illusoire, auquel adhèrent beaucoup de politologues, que de nombreux États ont récemment été jugés comme étant faibles (si le monopole de la violence est remis en question) ou défaillants (s’il n’est plus possible d’assurer ce monopole).
D’après moi, la définition de Weber attribue faussement à l’État public une cohérence qu’il ne possède pas, qui n’a jamais existé et qui aura de moins en moins de chances de se concrétiser à mesure que la démocratie se développe. Même aux USA, l’un des États les plus viables, a toujours existé un espace de négativité dans lequel le supramonde, le pouvoir entrepreneurial et la violence secrètement organisée sont interconnectés et collaborent entre eux. Dans cet espace, des règles sont appliquées par des pouvoirs qui ne tirent aucune légitimité de l’État public.
La ville de Chicago après la seconde guerre mondiale constitue peut-être l’exemple le plus frappant pour illustrer cette forme d’autorité non étatique. En 1962, une condamnation pour meurtre, prononcée après une enquête du FBI ordonnée par le ministre de la Justice Robert Kennedy, a été la première décision de justice depuis 1934 à punir un homicide lié au crime organisé – après trois décennies marquées par environ un millier d’assassinats non résolus.27 De nombreuses grosses fortunes « légitimes » d’envergure nationale trouvaient leur origine dans la corruption mafieuse de Chicago ; et la domination de la mairie de cette ville par les truands créa un climat d’impunité dans lequel prospéraient les industriels et les financiers les mieux connectés.
Peu après la création du Conseil National de Sécurité [NSC] en 1947, l’une de ses premières actions fut de blanchir pour « plus de 10 millions de dollars de fonds saisis à l’Axe afin d’influencer l’élection [italienne de 1948] ».28 Ce recours à des financements hors registres pour organiser des activités criminelles fut institutionnalisé en 1948 avec la création du Bureau de Coordination Politique (Office of Policy Coordination ou OPC), une agence secrète dont la mission était de s’engager dans « la subversion contre les États hostiles ».29 En conséquence, la Direction des opérations de la CIA, qui avait absorbé l’OPC en 1952, s’est depuis accoutumée à la violation routinière et quotidienne des lois dans les pays étrangers, malgré la condamnation du Congrès.30
En Europe, l’OPC engagea des trafiquants de drogue comme alliés pour défendre les États de l’Europe de l’Ouest contre les risques d’une prise de pouvoir par les communistes ou par les Russes. Dans le Sud-Est asiatique, l’OPC alla bien plus loin que la simple constitution d’alliances avec des trafiquants de drogue ; à travers l’opération Paper, il arma et aida ses soutiens narcotiques à mettre en place et à contrôler un vaste trafic international d’opium et d’héroïne (voir plus loin pour plus de détails sur cette opération). Nous verrons que dans ces actions, les objectifs de l’OPC n’étaient pas essentiellement défensifs comme en Europe. En effet, n’ayant pas d’autres alliés fiables, l’OPC utilisa l’argent de la drogue pour contribuer à développer une force anticommuniste offensive, qui partage une grande part de responsabilité dans la reprise de la guerre d’Indochine en 1959. Nous devons encore aujourd’hui faire face au problème du trafic de drogue jadis favorisé par l’OPC, car la majeure partie de ce trafic s’est peu à peu déplacée du Sud-Est asiatique vers l’Afghanistan. Ce livre démontrera comment l’utilisation par les États-Unis des barons de la drogue en Asie, combinée à l’absorption de l’OPC par la bureaucratie US en 1952, a contribué à passer de l’établissement traditionnel d’une défense anticommuniste en Europe à quelque chose de bien différent en Asie : une machine de guerre américaine offensive.31
À ses débuts, l’OPC était intégralement dominé par des membres du New York Social Register issus du supramonde de Wall Street, à l’instar de son directeur Frank Wisner. Toutefois, les relations de l’État avec les forces profondes ont considérablement évolué depuis les années 1940. La CIA, en particulier, fut partiellement chapeautée et soumise par le Congrès à une mesure de supervision bureaucratique. S’en est suivie la création de nouvelles institutions spécifiquement conçues pour échapper à l’impératif légal de transparence devant le Congrès. L’exemple le plus concret de ce phénomène est le Joint Special Operations Command (JSOC) créé en 1980 par le Pentagone, qui semble jouer un rôle comparable à celui de la CIA. Par exemple, le JSOC aurait établi des contacts en Iran avec au moins deux groupes dissidents qui sont impliqués dans le trafic de drogue.32
Aujourd’hui, le plus célèbre (et peut-être le plus important) exemple d’un pouvoir profond non responsable est probablement la société Blackwater, dorénavant rebaptisée Xe Services.33 Après que Leon Panetta, alors directeur de la CIA, eut annoncé en juin 2009 qu’il avait annulé le programme d’assassinats de l’Agence, l’hebdomadaire The Nation rapporta que Blackwater continuait à en perpétrer dans le cadre d’opérations clandestines menées avec le JSOC :
«Depuis une base avancée secrète dirigée par le Joint Special Operations Command (JSOC) et située dans la ville portuaire pakis- tanaise de Karachi, des membres d’une division d’élite de Blackwater sont au cœur d’un programme clandestin dans lequel ils planifient des assassinats ciblés d’agents présumés des Talibans et d’al-Qaïda, des ‘détections/enlèvements’ de cibles de grande valeur et d’autres actions sensibles à l’intérieur comme à l’extérieur du Pakistan, selon une enquête de The Nation. » 34
Nous reviendrons plus en détails sur Blackwater. Je veux simplement souligner à quel point le milieu social d’Erik Prince, le propriétaire de cette entreprise, est aux antipodes des vieilles fortunes de l’establishment composant l’OPC de 1948. Prince est un entrepreneur « nouveau riche » du Midwest, et sa fortune provient de ses contrats avec la machine de guerre dont il fait partie. Edgar Prince, son père, était un dirigeant clé (et sa mère la présidente) du Council for National Policy, un groupe nationaliste d’extrême droite basé à Dallas, qui avait été ouvertement créé pour contrer les politiques internationalistes du Council on Foreign Relations de New York.
Aux États-Unis, ce déplacement du pouvoir de l’OPC vers Blackwater incarne le basculement de ce dernier demi-siècle d’une économie civile à une économie de guerre, de l’internationalisme au nationalisme, d’un establishment de défense à un establishment offensif. Nous pouvons trouver la clé de ce changement dans l’agitation politique des années 1970, dont le résultat fut la perpétuation d’une machine de guerre renforcée par le conflit au Vietnam.
L’opération Condor s’inscrit dans la période trouble des années 1970. Comme nous le verrons, ce dispositif était soutenu par la CIA et, avec l’assassinat de Letelier, il réussit à étendre ses opérations à Washington, le siège du gouvernement des États-Unis.