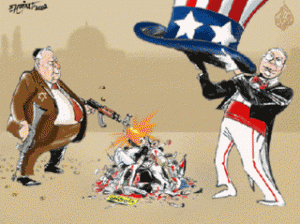Lorsque, le 1/11/1922, le général Mustapha Kamal, futur ‘ Ataturk’, détrôna le sultan Mehmet VI, il l’avait fait avec l’appui d’une bonne partie de ses compagnons d’armes, à leur tête son bras droit et successeur, le général Ismet Inonu. Mais lorsqu’il voulut abolir le Califat, il se heurta à l’opposition farouche du même Ismet Inonu pour qui les inepties commises dans l’exercice du pouvoir temporel ne devaient pas forcément rejaillir sur le volet spirituel de l’institution monarchique. Ataturk se résigna au diktat de son second et transféra le titre califal à Aldelmajid, l’aîné de la maison ottomane. Il s’accommoda de cette intransigeance encore un an avant de proclamer, officiellement, la république le 29/10/1923, et d’abolir définitivement le Califat le 3/3/1924. Ainsi, la Turquie vécut un cas sui generis durant presque deux ans, en tant qu’Etat engagé dans la voie de la laïcité, coiffé spirituellement par un Calife, en attente de ‘délégitimation’.
Trois décennies plus tard, le Maroc connut une situation, elle aussi, inédite. Comme Ataturk, sous pression d’Inonu, le général Guillaume, à défaut de pouvoir exaucer le souhait de Paris d’un changement radical du régime, a cru, lui aussi, devoir ménager la lignée dynastique, en procédant à un transfert de la Béïâ au sein de la même famille. Le Maroc se retrouva durant cinq jours, du 15 au 20 août 1953, avec deux sultans : Mohamed Ben Youssef, à Rabat, légitime, détrôné manu militari et en attente d’évacuer les lieux ; et Mohamed Ben Arafa, fantoche, intronisé malgré lui à Marrakech, et en attente d’occuper les lieux du précédent. Ce jeu de chaises musicales ne doit, sûrement, pas être étranger au fait que si la Béïâ est maintenue à titre rituel, folklorique pour certains, elle n’a jamais figuré dans aucune Constitution et n’intervient plus dans la légitimité de la succession au trône, assurée, désormais, héréditairement par ordre de primogéniture. Hassan II avait la mémoire longue et une sensibilité à fleur de peau. Il ne pouvait pas facilement oublier la trahison des Uléma qui ont basculé du côté de Ben Arafa. Pas plus, aussi, que les prétentions de Allal El Fassi de tirer la couverture à lui, lorsqu’il a déclaré à partir du Caire, aussitôt après la déposition du sultan Ben Youssef :< En tant que leader du parti de l’Istiqlal et membre du collège des Uléma de la Karaouiyine, qui seuls possèdent le droit de proclamer les rois, je…> ou encore : < Nous tenons à souligner que le régime du Maroc sera celui que nous bâtirons en accord avec notre peuple et notre Roi…> Hassan II avait, aussi, étudié l’Histoire, notamment la période des papes faiseurs et ‘défaiseurs’ de rois ; et il n’était, surtout, pas revenu six ans auparavant d’un exil qui eût pu être définitif et l’aurait envoyé rejoindre la cohorte des princes désargentés, pour se retrouver chambré par des Uléma faiseurs de sultans. Mieux encore, c’est lui qui s’est fait faiseur de Uléma. D’initiative ou sur proposition du Dr Khatib, il décide de les marginaliser en matière de succession dynastique. À une hypothétique proclamation transférable, reposant sur la seule conscience d’une poignée d’hommes officiant sur le moment, sujette à des pressions et tentations, il substitua la clause constitutionnelle de la Commanderie des Croyants légitimée par référendum censé traduire l’adhésion de toute la nation. Néanmoins, dans toutes les Constitutions de l’ancien règne, la disposition relative à la Commanderie des Croyants ne semblait pas assez lisible, ne présentait pas d’intérêt vital dans la quintessence du texte. Certains n’y croyaient absolument pas, ne lui reconnaissant aucun caractère réellement spirituel, l’assimilant, tout au plus, à une formulation sémantique pour renforcer, un peu plus, la sacralité du Roi dans l’esprit de ses ‘ sujets’ et, à l’international, rehausser, à la fois, politiquement, sa stature au diapason des ‘ Grands’ de l’époque tels que Nasser, Tito, Nehru, Bourguiba, Sukarno, le shah d’Iran, et aussi sa représentativité spirituelle au niveau du Pape et de reine Elisabeth, chef de l’église anglicane . D’autres, par contre, y voyaient une affirmation naturelle de l’exceptionnalité d’un souverain de droit divin. La Constitution en cours, de 2011, semble, elle, charrier une autre portée de la Commanderie des Croyants. Depuis le ‘Printemps arabe’, et ouverture démocratique interne et pression internationale obligeant, le Pouvoir se sait confronté à une situation inédite, susceptible d’amener à la gouvernance des formations peu loyales et peu soumises, qui seraient tentées de lui disputer des prérogatives fondamentales et lui contester certains privilèges et passe-droits. Des laïcs, d’abord, pourraient s’inspirer de la célèbre réplique de Abderrahim Bouabid < monarchiste, oui ; mais démocrate d’abord >, et exiger l’instauration d’un système constitutionnel sur le modèle britannique ou espagnol. La profusion des obédiences spirituelles -les zaouias- et l’intrusion en force des théologiens dans les médias, sont, de leur côté, de nature à susciter à terme une véritable guerre de fatwas risquant d’engendrer une brèche dans la cohésion sociale et par ricochet des répercussions politiques au niveau de l’organisation et du fonctionnement des institutions de l’Etat. Et pour preuve, le 28 juillet dernier, pour ne pas remonter plus loin, M. Raïssouni, éminent théologien, a proféré une philippique sans précédent contre l’État l’accusant d’utiliser le rite malékite pour parasiter le Mouvement islamiste et le marginaliser, ajoutant que l’État n’est pas tenu par l’observance obligatoire de ce rite mais qu’il l’instrumentalise sciemment à des fins subjectives. L’avènement au gouvernement du PJD issu, avant transit par le MPDC, du Mouvement Unicité et Réforme que présidait auparavant M. Raïssouni, précisément, pourrait bien n’être que le prélude à l’ascension, plus tard, sur la scène gouvernementale de mouvements plus radicaux, du genre salafiste-jihadiste, qui pourraient, dès lors, faire valoir, eux aussi, leur droit d’utiliser la puissance de l’État pour décréter officiellement en matière religieuse, puisque leur fondamentalisme les astreint à leur seule intime conviction.
J’avais déjà achevé la rédaction du présent article et m’apprêtais à le lancer lorsque au cours de la lecture du journal Al Massae du 7/9/2012, je suis tombé par hasard sur un article de M. Idriss Al Ganbouri, intitulé ‘ Les Salafistes et la Chiaâ…principaux défis de l’Islam politique après son accession au Pouvoir’, qui est venu conforter mon analyse. Il comporte une conclusion extrêmement instructive selon laquelle <…si l’islamisme apparenté aux Frères musulmans entrera forcément en conflit avec le salafisme, ce conflit restera, néanmoins, circonscrit au niveau de l’Etat ; mais il ne s’arrêtera pas là et évoluera en affrontement sunnito-chiite dont l’enjeu sera la Oumma > ( sic).
Si l’on y ajoutait les dispositions de l’article 3 de la Constitution qui garantit à tous le libre exercice des cultes, d’autant que le Chiisme est une composante islamique, le cas de figure ci-dessus pourrait bien, à moyen ou long terme, se jouer au Maroc, aussi. C’est, précisément, là que la nouvelle Commanderie des Croyants prend son aspect d’arme politique. Elle dote le Roi d’un pouvoir exclusif lui permettant de légiférer hors norme, par-dessus la tête du gouvernement et du parlement, dans des domaines où seules comptent sa volonté, sa vision et sa définition de ce volet du pouvoir régalien. Obéissant à son appréciation discrétionnaire, cette prérogative peut, du fait, aller au-delà du spirituellement correct pour servir de parapet contre tout dérapage dans une configuration politique complexe où il serait difficile de faire le distinguo entre l’aspect strictement spirituel et le politique. Il va de soi que dans l’esprit de la Constitution, la Commanderie des Croyants- article 41- prime sur la fonction de Chef de l’Etat- article 42- et du fait, la Fatwa royale, symbole de cette prééminence du spirituel sur le temporel, pourrait, tout simplement, servir d’arme d’excommunication pour délégitimer au plan religieux une gouvernance s’appuyant sur une majorité parlementaire absolue difficilement révocable par le jeu constitutionnel classique. Au passage, c’est une assurance pour l’Occident que la donne de la réalité du pouvoir reste là où elle a toujours été : au Palais. Nos Constituants avaient-ils derrière la tête une idée bien arrêtée au moment de la rédaction de l’article 41 ? Ont-ils simplement voulu compenser le pouvoir régalien de la perte de quelques prérogatives- somme toute mineures- en faveur du chef du gouvernement ou, au contraire, ont-ils volontairement ‘ fabriqué’ une nouvelle mouture de la monarchie exécutive ? La question est posée au Pr Menouni.